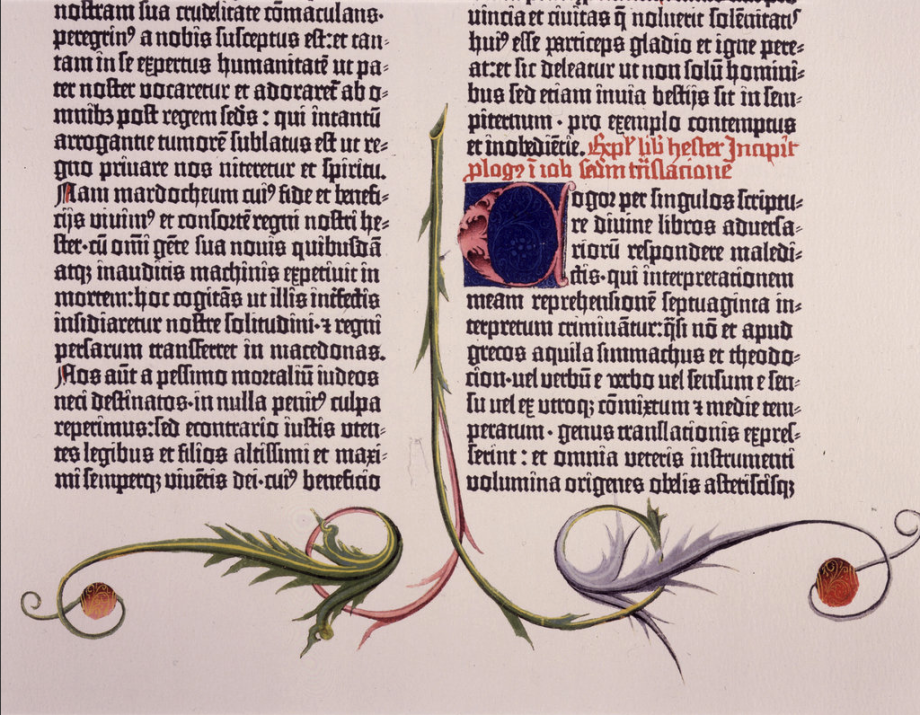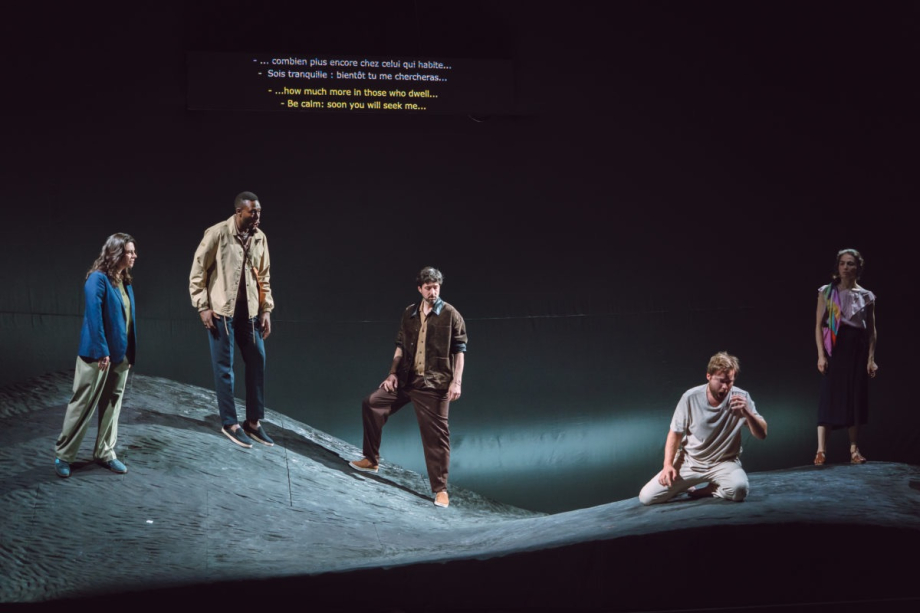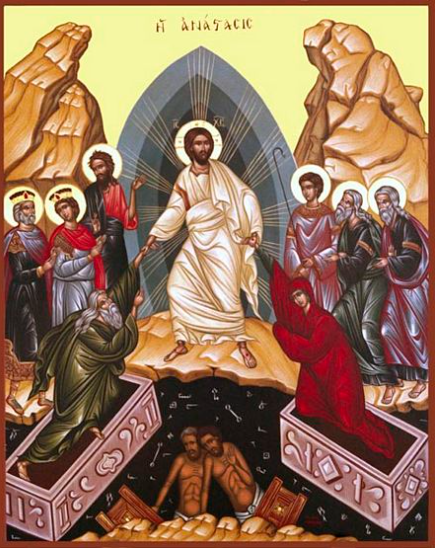Le Livre de Job : Exploration de la souffrance et de la justice divine
Le Livre de Job : Exploration de la souffrance et de la justice divine
Cet article est une traduction de l’original publié sur le site du monastère de Kovilj (Serbie):
https://orthodoxkovilje.rs/knjiga-o-jovu-manastir-kovilje/
Introduction
Dans le Livre de Job, la question de l’origine du mal, de la souffrance et du destin malheureux de l’homme est examinée. Il est question de la souffrance imméritée du juste, de son épreuve, et du silence de Dieu qui tarde à venir en aide au juste Job. Ce livre met en avant les justes et la justice, et soulève la question du sens et de la justification de la religiosité humaine et de la foi en Dieu face aux souffrances et aux malheurs que la vie quotidienne apporte. Chacun de nous peut se reconnaître en Job, car il n’existe personne qui, à un moment donné de sa vie, ne se soit pas confronté à une souffrance incompréhensible ou difficile à accepter. La question fondamentale dont nous allons parler est celle de l’existence humaine, c’est-à-dire la question de la source de la force qui aide l’homme à traverser toutes les épreuves et les difficultés de la vie sans renier ni lui-même, ni Dieu.
Prenons un instant pour évoquer, par les mots du professeur Vladeta Jerotić, ceux qui cherchent une réponse à la question de l’origine de leur souffrance. D’abord, il y a beaucoup de personnes qui ressemblent à Joseph K. dans Le Procès de Kafka. Elles se considèrent obstinément innocentes et ne peuvent comprendre pourquoi elles souffrent et pourquoi elles sont persécutées. Cependant, la faute de Joseph K. ne réside pas seulement dans le fait qu’il a dû se salir dans le fleuve de l’existence, mais surtout dans son isolement et son égoïsme, car il a oublié son prochain. Il n’est pas coupable parce qu’il aurait fait quelque chose de mal, car ce n’est pas le cas, mais parce qu’il n’a rien fait de bon. La deuxième catégorie est celle des personnes fascinées par le destin, le fatum ou la nécessité, qui n’examinent pas en profondeur l’origine de leurs malheurs, mais les acceptent parfois dans la stupidité et l’apathie, parfois avec une certaine noblesse, dans la résignation ou le stoïcisme, en espérant, ou non, un temps meilleur, ici ou ailleurs. Elles acceptent les événements sans jamais s’être d’abord interrogées elles-mêmes à leur sujet.
Bien sûr, la majorité des gens accusent sans compromis les autres pour tous les malheurs et maux qui leur arrivent ou à la société dans laquelle ils vivent : leurs parents, conjoints, supérieurs, la société entière. Partiellement ou complètement aveugles à leurs propres défauts, ils projettent leur mal sur leur entourage, cherchant parfois avec colère et amertume un objet de haine ou la destruction de tous leurs ennemis. Ce sont des pseudo-révolutionnaires, tournés tout entiers vers l’extérieur, tragiquement incapables de réfléchir aux paroles attribuées à Aldous Huxley selon lesquelles « il n’y a qu’un seul coin de l’univers que nous pouvons certainement améliorer, et c’est nous-mêmes. »
Enfin, il y a ceux qui commencent par eux-mêmes quand ils veulent trouver les raisons et justifications du mal qui les frappe. Bien qu’Alfred Adler ait raison de dire que la méconnaissance de soi est dangereuse pour la vie, se connaître n’est pas toujours sans danger. Beaucoup de personnes malades ou apparemment saines portent en elles un sentiment insupportable de culpabilité et ne savent que faire avec le mal qu’elles ont découvert en elles. Elles ignorent souvent le secret de la transformation et de la purification, qui est la seule voie capable de les mettre en action productive.
Job est le premier homme de l’histoire qui s’est rebellé contre la douleur et la souffrance, évitant de tomber dans le piège de la fausse innocence de Joseph K., du fataliste, du panthéiste du destin et de la nature, du pseudo-révolutionnaire qui ne cherche que le changement autour de lui, ou de l’introverti névrosé qui s’accuse stérilement et ne sait où aller avec ses fautes réelles ou reconnues. Job a accompli le plus grand exploit qui le place au-dessus du plus grand croyant de l’histoire, Abraham, en se rebellant contre Dieu lui-même, sans pour autant douter un seul instant de l’existence absolue de Dieu.
Le Livre de Job est l’une des œuvres majeures de la littérature universelle. Par sa profondeur spirituelle, son thème et son exaltation, il se rapproche du Nouveau Testament. Des indices laissent penser qu’il pourrait avoir été rédigé par plusieurs auteurs. Il appartient à la littérature sapientiale (avec les Proverbes, l’Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques) de l’Ancien Testament hébraïque. Il est impossible de dater précisément sa rédaction, mais on suppose qu’il a été composé vers le 6e siècle avant notre ère (certains chercheurs avancent le 5e siècle avant J.-C.).
Le livre s’appuie sur le récit d’un chef édomite qui s’est montré inflexible dans sa foi quand il fut éprouvé par Satan. Selon l’exégèse, Job serait une figure historique ayant vécu au 9e siècle avant notre ère, considéré comme un descendant d’Abraham à la cinquième génération.
Le nom Job est apparenté à la racine hébraïque איב (’-y-b) ayiv et peut signifier :
1. une question : où est le Père divin ?
2. un épithète : celui qui est haï, persécuté, en opposition.
Une forme grammaticale proche est le nom du roi édomite Jobab.
Le personnage principal du drame est Job. Inspiré par des écrits prophétiques et des sages, il est un héros de l’antiquité ayant probablement vécu dans le pays d’Uz, à la frontière de l’Arabie et d’Édom. On sait peu de choses sur son époque. L’histoire de Job se divise en trois périodes : la première – où il occupe une position élevée dans son pays, il est appelé roi ; la deuxième – où il traverse l’épreuve, perd tout ; la troisième – où il reste fidèle à Dieu et ne suit pas ses instincts.
Job accepte que ce qui lui arrive est la volonté divine, sans pour autant la comprendre. Il maudit le jour de sa naissance, mais ne maudit pas Dieu. Trois amis, Bildad, Élifaz et Sophar, viennent lui rendre visite et affirment qu’il a péché pour mériter tant de malheurs. Malgré leurs arguments implacables et la pression pour qu’il avoue ses péchés, Job reste ferme, et ses amis finissent par se taire. Puis, Elihou, hésitant à parler à cause de sa jeunesse, affirme que si Job est coupable de quelque chose, c’est d’orgueil, car en défendant sa justice et en cherchant les raisons divines, il s’est placé au-dessus de Dieu. Après l’intervention d’Elihou, Job a une vision de Dieu apparaissant dans un tourbillon, le réprimandant d’avoir questionné Ses motifs. Dieu montre alors combien la terre est pleine de merveilles et de mystères que Job ne peut comprendre, ainsi que les monstrueux processus en cours (Behemoth et Léviathan sont des créatures mythiques dans la tradition juive – Job 40, 20-28 et 41, 1-25) que Job ne peut contrôler. Job retrouve son humilité, sa foi est entièrement renouvelée, et il est récompensé par la restauration de sa santé et de ses enfants. Ses biens sont doublés. Job meurt vieux et satisfait.
Northrop Frye fait une comparaison intéressante – Job, comme Adam, tombe dans un monde de souffrance et d’exil, traverse une métamorphose de conscience, mais retrouve ensuite son état primordial, avec une récompense. Les souffrances de Job ne sont pas une punition mais une épreuve.
Le Livre de Job relativise la question de la justice; en réalité, il ouvre cette question éternelle : pourquoi le juste souffre-t-il, s’il n’a pas péché ? Si les relations humaines sont bâties sur le principe du mérite (récompense ou punition, peu importe), est-il possible que ce principe ne s’applique pas dans la relation avec Dieu ? Peut-on donner une autre réponse que celle-ci : Dieu, en tant que source et mesure de la justice, est-il responsable de toutes les souffrances et les épreuves ? Si Dieu est la mesure de la justice et son origine, n’est-il pas pleinement appelé à répondre aussi de la punition infligée aux justes ? Dans le Livre de Job, constate Zvonimir Kostić, on reconnaît l’injustice, mais Dieu n’est pas accusé d’en être la cause. Carl Gustav Jung, quant à lui, estime que Job ne peut nier qu’il se trouve face à un Dieu qui ne se soucie pas du jugement moral et qui ne reconnaît pas envers lui-même une éthique contraignante. Job est opposé à un Dieu pour qui la puissance importe plus que la justice. Ainsi, dans sa discussion psychologique « La Réponse à Job », Jung déclare : « La grandeur de Job réside sans doute dans le fait qu’il ne perd pas confiance dans l’unité de Dieu face aux difficultés, mais qu’il voit clairement que Dieu est en contradiction avec lui-même, une contradiction si totale que Job est certain de trouver en Dieu un défenseur et un avocat contre Dieu. » Job doit reconnaître que personne d’autre ne lui fait tort ni ne lui inflige de violence, si ce n’est Yahvé lui-même. Il est difficile de comprendre que la justice de Dieu est en un sens automatique, rigoureuse et inévitable, du moins d’après ce que témoignent la Torah et les livres prophétiques.
En abordant la question de la souffrance de l’innocent, qui constitue la problématique centrale du Livre de Job, il faut mentionner les textes parallèles akkadiens et sumériens. Ils sont beaucoup plus anciens et datent d’entre 1800 et 800 av. J.-C. On peut y voir certaines similarités formelles et de contenu. Pourtant, ces textes restent dans le cadre de la religion du Proche-Orient, sans atteindre la profondeur ni la force du Job de l’Ancien Testament. De même, ils ne contiennent pas de théophanie avec des discours divins qui instruisent Job et le replacent dans le contexte qui, selon le plan divin, lui revient dans le cosmos.
Le problème traité par le Livre de Job se rencontre aussi dans les livres prophétiques. Il s’agit de la responsabilité, de la souffrance et de la culpabilité. Dans la Torah de Moïse, cette question est résolue d’une manière unique, par la conception de la responsabilité collective. Pour le péché des pères, les descendants en portent la punition, même s’ils ne sont en rien coupables. Les Israélites étaient convaincus que chaque péché devait être expié, que ce soit par un individu ou par la communauté. Cela signifie que la souffrance pouvait retomber sur un individu, mais aussi sur ses fils, ses descendants, ses serviteurs… Ainsi, si quelqu’un du peuple d’Israël se trouvait en difficulté, il fallait chercher la cause dans le péché de cet individu ou de la communauté (parents, famille, proches, peuple) à laquelle il était lié. Cette opinion traverse toute l’Ancien Testament, et elle est même encore présente chez les disciples de Jésus qui demandent au Maître : « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? » (Jean 9,2). Au fur et à mesure de la maturation du monothéisme éthique, ce fatalisme est devenu insoutenable, car la responsabilité collective était contraire au concept de justice divine. Les prophètes Jérémie et Ézéchiel ont proclamé que chaque homme est personnellement responsable devant Dieu de ses actes, et ils se sont ainsi opposés à la thèse rigide de la Torah. Ce fut un pas révolutionnaire et un immense progrès dans la pensée religieuse. Cependant, en précisant la responsabilité, le grand problème humain ne fut pas résolu, mais devint encore plus complexe. Car si chaque homme est personnellement responsable de ses actes, pourquoi les justes et les pieux souffrent-ils ? s’interroge Job, qui, comme tous les esprits révolutionnaires, pose une question prématurée. Rappelons que la réponse chrétienne à la question de Job fut théologiquement développée bien plus tard, sur le plan existentiel. Les souffrances terrestres des justes, dans le christianisme, seront rachetées dans le royaume du Christ à venir.
Composition du Livre de Job
Livre de Job, Bible de Gutenberg
La forme principale de la littérature sapientiale est le mashal (en hébreu משל ) c’est-à-dire la parabole (en grec), ce qui signifie une histoire dont la couche superficielle renvoie à un sens spirituel plus profond. Le type le plus simple de mashal est le proverbe sous forme de distique. Le Livre de Job, qui se compose d’un prologue et d’un épilogue en prose, d’une partie centrale poétique formée de trois cycles de débats, et de la réponse de Dieu venue du tourbillon, possède également une forme plus étendue de mashal.
Ce livre, à la fois sapientiel et instructif, a aussi un caractère dramatique.
1. Prologue en prose
2. Trois cycles de débats :
2.1. La plainte de Job ;
2.2. Premier cycle : Élifaz / réponse de Job ; Bildad / réponse de Job ; Sophar / réponse de Job ;
2.3. Deuxième cycle : Élifaz / réponse de Job ; Bildad / réponse de Job ; Sophar / réponse de Job ;
2.4. Troisième cycle : Élifaz / réponse de Job ; Bildad / réponse de Job ; Chant de la sagesse ; défense finale de Job ; discours d’Élihou
3. Réponse de Dieu venue du tourbillon :
3.1. Premier discours / Job s’humilie ;
3.2. Deuxième discours / Job se repent
4. Épilogue en prose
Les petits justes dans le monde sont éprouvés par les hommes et par les forces de la nature, mais les grands justes ont toujours été éprouvés par Dieu lui-même. Ce fut le cas d’Abraham, ainsi que celui de Job. C’est pourquoi Job est la figure paradigmatique de l’homme de foi, d’espérance, de patience et de paix. Il confesse sa foi en Dieu qu’il ne voit pas, et à la fin Dieu se révèle à Job.
Pour mieux comprendre, rappelons brièvement le concept de théophanie.
La théophanie est la manifestation du vrai Dieu et sa pénétration dans le monde de l’homme. Cela rend possible l’établissement d’une relation proche entre l’homme et Dieu, ce qui permet réellement le développement humain et la survie. La théophanie vient de Dieu lui-même et représente un enrichissement et une libération de ce qui existe ; un enrichissement par la dimension divine. La théophanie est Dieu dans l’acte de révélation et de don de Lui-même à l’homme. C’est ce que la Bible appelle la « révélation ». Cela nous aide grandement à interpréter une des couches du Livre de Job.
La partie en prose du Livre de Job est plus ancienne que ses parties poétiques. Il s’agissait d’un petit livre en prose avec dialogue et théophanie. En ajoutant de nouveaux éléments, l’œuvre a pris sa forme actuelle. Selon Harrington, l’histoire de Job, c’est-à-dire la partie en prose du poème, a dû circuler oralement pendant de nombreuses années avant d’être mise par écrit dans la forme que nous possédons aujourd’hui.
Dans la disposition originelle, le Chant de la sagesse et le discours d’Élihou ont été ajoutés ultérieurement. Élihou n’est mentionné ni comme ami de Job dans le prologue ni dans l’épilogue. Son conseil intervient après les débats de Job avec ses amis.
Dans la partie prologuée en prose, se déroule un dialogue entre Dieu et Satan. Dans la partie poétique centrale, il n’y a aucune allusion à ce dialogue. Cela a conduit certains chercheurs à conclure que la partie poétique est une interpolation ultérieure d’un auteur inconnu.
Satan parcourt la Terre à la recherche d’humains pécheurs, jouant un rôle de procureur. Dans le Livre de Job, Satan n’est pas l’esprit maléfique de la tradition biblique plus tardive. Dans le cas de Job, il persiste dans sa conviction que les hommes, et même Job, ne respectent pas sincèrement Dieu, mais ne le glorifient que tant qu’ils ressentent sa faveur et reçoivent la récompense pour leur justice.
Le rôle de Satan dans le Livre de Job
Examinons une digression qui nous aide à mieux comprendre le Livre de Job.
Tout d’abord, il faut souligner que le nom « Satan » vient du mot hébreu שָׂטָן (śāṭān), qui provient de la racine d’un verbe qui s’écrit de la même façon que le mot satan (se prononce siten) et signifie « s’opposer », « résister ». Ainsi, le nom satan signifie adversaire ou opposant, celui qui s’oppose ou résiste à quelque chose. Ce mot n’apparaît jamais dans le Tanakh (Ancien Testament) comme un nom propre, mais comme un nom commun, tout comme « serviteur » ou « roi ».
En hébreu, il existe un article défini « ha » הַ (ha-), similaire à l’article défini anglais THE. Cet article « ha » peut se trouver devant un nom commun, mais JAMAIS devant un nom propre (c’est pareil en anglais). C’est pourquoi on ne peut pas dire HaDavid ou The David, mais on peut dire HaOved ou The Servant parce que satan est un nom commun et non un nom propre comme David ou Juda. En hébreu, l’article défini est parfois utilisé devant le nom satan, comme dans le Livre de Job. C’est pourquoi, par exemple, dans la Septante, la traduction grecque du Tanakh, HaSatan est traduit par « diábolos » (diable), car les noms communs sont toujours traduits, tandis que les noms propres sont généralement translittérés.
Beaucoup pensent que ce mot apparaît pour la première fois dans le Livre de Job ou dans le livre du prophète Zacharie. Cependant, la première utilisation de ce mot se trouve dans le récit de Balaam et Balak, au livre des Nombres, chapitre 22. Regardons qui est appelé là « Satan » ? Dans cet événement précis, « Satan » est le nom donné à l’ange du Seigneur. On lit :
« Mais Dieu s’irrita parce qu’il partit ; et l’ange du Seigneur se posta sur le chemin pour lui barrer la route… » (Nombres 22:22)
Cependant, le texte littéral dit « qu’il lui soit satan », autrement dit « qu’il lui soit adversaire ». Dans la traduction de Daničić, le verbe utilisé masque quelque peu le sens de la phrase.
Ce qui est important pour nous ici, c’est que « satan » n’est en aucun cas un ennemi de Dieu ou, de manière générale, un ennemi de l’humanité. Ainsi, dans la Torah (appelée librement la «Loi», c’est-à-dire les livres de Moïse, le Pentateuque), nous avons un cas où « Satan » est le serviteur de Dieu, c’est-à-dire l’ange du Seigneur envoyé pour être adversaire de Balaam. Au verset 32 du même chapitre, ce point est répété et l’ange lui-même confirme qu’il est « Satan », et au verset 35, il parle au nom de Dieu. Que pouvons-nous en conclure ?
Quand Dieu se met en colère contre quelqu’un, Il peut envoyer Son ange pour être son adversaire, c’est-à-dire « Satan », afin de le punir. Dans ce cas, « Satan » ne fait qu’exécuter la volonté de Dieu, il n’est en aucun cas en rébellion contre Lui.
Dans le Premier Livre de Samuel, on voit que « Satan » peut aussi être un homme (ici David), et pas seulement un ange. Cela nous montre que le mot « Satan » désigne simplement une action d’opposition ou de résistance menée par une entité, que ce soit un ange ou un homme.
Le destin de Satan a été réglé par la venue du Christ : « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair » (Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 18). Il ne faut pas oublier que, depuis sa chute, le royaume de Satan est, et reste seulement la terre.
La vie après la mort dans le Livre de Job
Pour bien comprendre le Livre de Job, il est important de savoir qu’il a été écrit à une époque où les Juifs ne concevaient pas encore d’idée de vie après la mort ni de récompense pour les souffrances endurées sur terre. Pour eux, l’au-delà se résumait à un séjour dans le Shéol (le séjour des morts), un lieu souterrain sans joie, sans connaissance, sans action ni espérance. Dans ce nouveau lieu d’habitation, tous sont égaux : riches et pauvres, bons et mauvais. Il n’y avait donc aucune place « là-bas » pour une récompense des bonnes actions accomplies ici-bas.
Ainsi, du point de vue de l’époque, la seule récompense envisageable pour la piété et les bonnes œuvres devait se manifester dans cette vie. La rétribution du bien ou la punition du mal était perçue dans une perspective terrestre. C’est pour cela que l’idée d’une récompense dans le présent rencontre des difficultés insurmontables (comme l’écrit Harrington dans son Introduction à l’Ancien Testament). Le Livre de Job illustre précisément ces difficultés et marque une avancée dans la recherche d’une solution conforme à la réalité. L’idée d’une récompense pour le juste après la mort n’apparaîtra que dans la première moitié du IIe siècle avant notre ère.
En renforçant progressivement le principe du Moi individuel, et en plaçant les besoins personnels de l’homme au même niveau que ceux du collectif, les anciens Hébreux se sont concentrés sur deux idées :
1. La première est que la cohésion et la force d’une communauté nationale unie par une même langue et une même foi, ne peuvent être maintenues et développées que par le renforcement de l’idée commune de justice dans chaque individu appartenant à cette communauté.
2. La seconde découle de l’observation récurrente que l’idée humaine de la justice divine est faible et instable, simplement parce qu’à toute époque, que l’on croie ou non en Yahvé, on pouvait constater que, bien souvent, les justes souffrent et peinent dans ce monde, tandis que les méchants et les violents de toutes sortes prospèrent.
C’est pourquoi les Hébreux durent eux aussi, comme d’autres peuples, se tourner vers l’hypothèse d’une vie après la mort.
Mais cette époque n’était pas encore venue. C’est pourquoi Job, avec audace et résolution, réclame une explication de la part de Dieu, une réponse et un apaisement – ici-bas, sur terre, nécessairement ici. Job croit-il en l’immortalité ? Ce n’est pas clairement exprimé dans l’ensemble du Livre de Job.
Au chapitre 14, on trouve presque verset après verset des opinions opposées sur la mort et l’immortalité exprimées par Job lui-même. Tandis qu’au verset 10, Job dit :
« Mais l’homme meurt, et où est-il ? Comme les eaux s’évanouissent d’un lac, comme un fleuve tarit et se dessèche, ainsi l’homme se couche et ne se relève plus ; tant que durent les cieux, il ne s’éveillera pas, il ne sortira pas de son sommeil. »
…au verset 14 cependant, on trouve déjà une allusion à une foi naissante en l’immortalité - ou du moins en cours de consolidation à l’époque de la rédaction du livre , foi exprimée ainsi :
« Si l’homme meurt, revivra-t-il ? Tous les jours de mon service j’attendrai, jusqu’à ce que vienne ma transformation. Tu m’appelleras, et je te répondrai ; tu désireras l’œuvre de tes mains. »
Job comme héros contemporain
La Cité Bleue, Genève: Job, le procès de Dieu
Considéré d’un point de vue philosophique, le Livre de Job aborde l’une des questions les plus fondamentales de l’existence humaine : celle de la souffrance injustifiée de l’homme. En ce sens, ce livre traite d’un problème universel, toujours présent dans notre société contemporaine. C’est pourquoi l’une des lectures possibles de Job est de le considérer comme une figure moderne.
Contrairement aux héros modernes de la philosophie et de la littérature existentialistes, qui – à l’image des figures de l’absurde – adoptent une attitude « passive » face au monde, le Job de l’Ancien Testament, avec toute la force de son esprit, cherche un sens. Le simple fait qu’une idée de sens existe neutralise la maxime de la philosophie de l’absurde selon laquelle il n’y a pas de sens. C’est là le piège de la philosophie de l’absurde : elle met en lumière l’aspect absurde de la réalité – ce que fait aussi le Livre de Job – mais sans pour autant nier l’existence d’un sens. Le Livre de Job cherche ce sens. C’est cette volonté de relativiser les vérités établies et de poser des questions qui fait de Job un héros moderne.
D’un point de vue psychologique, ou plus précisément psychanalytique, le Livre de Job est une parabole sur la connaissance de soi. Il témoigne de la nécessité, pour Job, de se détacher d’abord du collectif – de la religion collective et de la conscience tribale – pour ensuite, en tant qu’individu, mûrir en une personne capable d’assumer toutes les conséquences de son comportement sur le chemin de la divinisation.
Ce n’est qu’en tant que personne que Job peut rejeter le modèle autoritaire et entamer un dialogue (communion avec Dieu) avec une autre Personne. L’essence de cette communion réside dans le rapprochement de l’image humaine à son archétype divin. Le bien-être initial de Job, décrit au début du livre, symbolise son « infantilisme » ; pour mûrir, il doit être mis à l’épreuve, et c’est cette épreuve qui l’inspire à se rebeller, ce qui lui permet de rejeter le langage de l’ordre, souvent utilisé pour parler aux « enfants ». En se connaissant lui-même – dans sa conscience comme dans son inconscient – Job sera capable de connaître Dieu. Il doit chercher une explication à sa souffrance, désirer un dialogue avec Dieu, car le temps de ce dialogue est venu – c’est là un schéma presque archétypal du processus de maturation de tout être humain.
Le Livre de Job reflète aussi un phénomène sociologique contemporain : l’étroitesse d’esprit d’une société incapable d’accepter un individu qui, de quelque manière que ce soit, s’écarte des normes préétablies de comportement. Il suggère, de manière implicite, le problème des idéologies totalitaires – l’un des grands défis des sociétés modernes.
Les plus fidèles serviteurs du totalitarisme, sans lesquels aucun régime totalitaire ne pourrait exister, sont les « amis » de Job. L’exigence d’une victime soumise et consentante caractérise le totalitarisme contemporain.
René Girard ajoute :
« Les sacrifices humains sont toujours présentés comme entièrement consentants à leur souffrance, totalement convaincus de sa nécessité. C’est le point de vue des persécuteurs, que le néo-primitivisme moderne est incapable de remettre en question. »
L’aspect religieux du Livre de Job
La Crucifixion du Christ
L’aspect religieux de ce Livre indique sans équivoque un moment très important dans le développement de la pensée religieuse en général. Le Livre de Job rompt avec une perception dogmatique de Dieu qui suppose une « obéissance aveugle » et exclut totalement la rationalité. La recherche du dialogue par Job semble être d’une importance essentielle pour l’expérience même de la foi et la relation de l’homme à celle-ci, car c’est précisément la possibilité du dialogue qui rend l’homme plus grand et plus fort qu’il ne l’est en réalité.
D’un point de vue théologique, le Livre de Job introduit aussi l’idée de la mise à l’épreuve de l’homme, autrement dit, l’épreuve de l’amour. L’épreuve n’est pas un caprice du Seigneur, mais Sa providence, qui pousse l’homme à sortir de son état de passivité, contribuant ainsi à son élévation intellectuelle et à son renforcement qualitatif dans les contextes esthétique, éthique et moral.
Job est un rebelle et un fidèle adorateur de l’amour, et en tant que tel, il restera fidèle à Dieu même dans les épreuves les plus difficiles. Leszek Kołakowski, dans son article Job ou l’antinomie de la vertu, soutient pourtant que Job, en restant fidèle à Dieu même dans les tourments les plus douloureux, commet en réalité le mal, alors qu’il souhaite faire le bien. En d’autres termes, la fidélité est ambiguë et équivoque.
«La fidélité est une vertu intérieurement contradictoire : si elle est cultivée dans l’espoir d’un bénéfice, elle cesse d’être une vertu ; mais si elle est cultivée pour elle-même, la fidélité devient souvent une acceptation du mal, et cesse alors, elle aussi, d’être une vertu.»
La souffrance de Job est, selon l’opinion des exégètes chrétiens, une anticipation des souffrances du Christ. On trouve chez les théologiens chrétiens des interprétations selon lesquelles l’on conclut que Job, dans l’Ancien Testament, annonce prophétiquement le Christ, médiateur entre l’humanité déchue et Dieu. Le fil conducteur qui relie indubitablement le Christ et Job est la souffrance, car elle est le seul chemin vers la réconciliation entre l’homme et Dieu.
Par la souffrance et la passion du Christ, Dieu le Père, à travers le Fils, s’identifie à l’homme dans la souffrance.
« De même que l’homme souffre à cause de Dieu, Dieu aussi doit souffrir à cause de l’homme. Il ne peut y avoir de réconciliation entre eux autrement », estime Carl Gustav Jung.
Sergueï Boulgakov, dans son ouvrage La Sophiologie (de la mort), exprime une opinion presque identique sur la nécessité de la souffrance comme moyen de rapprocher Dieu de l’homme.
L’aspect littéraire et artistique du Livre de Job
Le Livre de Job est la première synthèse de la religion, de la philosophie et de l’art. D’un point de vue littéraire et artistique, le Livre de Job est l’un des écrits les plus complexes de toute la littérature mondiale. Son genre est extrêmement élaboré : à la fois drame, poème, récit fantastique, tragédie, et théâtre de l’absurde. Il se distingue par la concision de son expression et la richesse des images artistiques, parmi lesquelles dominent assurément les scènes terribles de la souffrance et de la détresse de Job, opposées à la splendeur majestueuse de la nature.
L’ensemble de l’œuvre est conçu selon deux pôles opposés : la défense et le silence. La défense est en réalité la sincérité du juste souffrant, d’où ressortent la relation de Job aux hommes et au travail, ainsi que la crainte de Dieu qui imprègne toute sa vie. La défense de Job se trouve dans la partie poétique du poème, lorsqu’il se dresse, accablé d’accusations, contre tous, atteignant ainsi les sommets de son être personnel et de sa sagesse. Job ne prétend pas être innocent (aucun homme n’est sans péché), mais affirme que ce qui lui est arrivé n’est pas proportionné à ce qu’il aurait pu faire. Cela se voit dans le passage suivant :
« Si j’ai marché dans le mensonge, ou si mon pied s’est hâté vers la tromperie,
qu’il me pèse sur la balance juste, et que Dieu reconnaisse mon intégrité. »
(Job 31, 5-6)
D’un autre côté, on peut clairement distinguer dans ce poème le motif de la connaissance à travers le silence. Le silence représente la réponse à la souffrance qui s’élève sur le chemin; c’est une réponse sous forme d’adoration et de respect inconditionnels. Rappelons-nous de la théophanie : en se manifestant, Dieu révèle Job à lui-même, et c’est ainsi, en connaissant Dieu, que Job parvient à se connaître lui-même et décide que son silence sera et demeurera le langage de sa foi. Ainsi, nous contemplons Job comme un homme qui, de manière éloquente et abondante, se tait, tandis que son silence humain devient un véritable dialogue d’amour.
Pour comprendre la signification du silence, regardons le premier discours de Dieu depuis la tempête. Toute l’explication se cache dans les versets suivants :
« Alors Job répondit au Seigneur et dit :
Voici, je suis peu de chose, que pourrais-je Te répondre ?
Je mets ma main sur ma bouche,
J’ai parlé une fois, mais je ne répondrai plus ; deux fois, mais je n’ajouterai rien. »
(Job 40, 3–5)
La définition de la sagesse dans le Livre de Job
Une autre définition importante dans le Livre de Job est la précision et l’approfondissement du concept de sagesse, au chapitre 28, ce qui est essentiel pour comprendre la problématique de l’ouvrage :
« D’où vient donc la sagesse ? Et où est le lieu de l’intelligence ?
Elle est cachée aux yeux de tout vivant, et voilée aux oiseaux du ciel.
L’Abîme et la Mort disent : Nous avons entendu parler d’elle de nos oreilles.
Dieu en connaît le chemin, Il connaît son lieu.
Car Il regarde jusqu’aux extrémités de la terre, Il voit tout ce qui est sous les cieux.
Quand Il donnait au vent son poids, et qu’Il mesurait les eaux,
Quand Il imposait une loi à la pluie, et un chemin à l’éclair du tonnerre,
Alors Il la vit et la proclama, Il l’établit et la scruta.
Et Il dit à l’homme : Voici, la crainte du Seigneur, voilà la sagesse,
Et s’éloigner du mal, voilà l’intelligence. »
(Job 28, 20–28)
Ces versets posent les frontières infranchissables de l’homme qui aspire à la sagesse. Ce sont des limites que l’homme ne peut dépasser. Le secret de la sagesse et son lieu demeurent cachés à toute la création. Dieu seul connaît la sagesse et le chemin qui y mène. Lui seul sait où elle se trouve. Lui seul connaît les mystères de la création dans l’espace et le temps. Son regard s’étend au-delà des confins de la terre. Il a une vue sur les fondements de l’univers, qui restent cachés à l’homme.
Lors de la création du monde, la sagesse est entrée dans l’œuvre comme un « modèle divin », comme une « formule du monde » de Dieu. Par la mesure, le nombre et le poids, Dieu a créé le monde comme expression de Son dessein divin.
Dans cette forme d’autonomisation de la sagesse, c’est le principe actif dans la création divine qui est souligné. Comme un ingénieur ou un architecte, la sagesse a mis en œuvre le plan divin de la création. Cela indique que Dieu est le seul Maître de la création. Puisque la création est propre à Dieu seul, Il n’a confié la sagesse à aucun homme. Car cette sagesse demeure exclusivement du côté de Dieu et révèle l’écart insurmontable – la distance – entre le Dieu tout-puissant caché et l’homme limité.
En ce qui concerne la sagesse, l’homme atteint la limite ultime de ses capacités et de ses possibilités. Il ne lui est pas permis d’aller dans l’infini selon sa curiosité ou son désir d’exploration. Il ne peut ainsi atteindre la sagesse. La sagesse humaine est d’une tout autre nature. Elle est la crainte de Dieu. Cette sagesse implique, d’une part, la distance, mais aussi, d’autre part, la proximité avec Dieu. Ainsi, la sagesse apparaît comme un concept qui correspond à une loi, une règle, un type ou un modèle, c’est-à-dire une notion qui a été implantée dans chaque créature selon son espèce lors de la création. Par conséquent, la sagesse divine est fondamentalement différente de celle de l’homme.
De cette manière, le chapitre 28 constitue la conclusion d’un long débat mené à travers trois cycles de dialogues. Et autant de réflexions, de spéculations et de discussions ne peuvent résoudre la question existentielle de la grande souffrance qui a frappé Job, ni en définir le sens. La voie suivie jusqu’ici, malgré tous les efforts de la raison humaine, ne mène à aucun résultat. Si l’on veut éclairer les ténèbres, cela n’est possible qu’avec l’aide de Dieu et de Sa sagesse, car les capacités humaines ne suffisent pas pour cela.
Le mal, le péché et le problème de la théodicée
L’autre aspect du Livre de Job – non plus personnel et individuel, mais général et universel, présenté à travers le destin d’un seul homme – nous confronte au problème de la théodicée : la justification de Dieu face à l’existence du mal dans ce qui, selon Leibniz, est « le meilleur des mondes possibles ».
Commençons par une question formulée déjà par Épicure :
Dieu veut-il supprimer le mal, mais n’en a pas le pouvoir ? Ou bien en a-t-il le pouvoir, mais ne le veut pas ? Ou encore n’en a-t-il ni le pouvoir ni la volonté ?
S’il le veut mais ne le peut pas, il est impuissant.
S’il le peut mais ne le veut pas, il est mauvais.
Mais s’il le peut et le veut, d’où vient alors le mal dans le monde ?
Saint Augustin, dans ses Confessions, pose une question semblable : « D’où vient le mal, puisque Dieu, qui est bon, a créé toutes choses bonnes ? »
Voyons quelques tentatives de réponse.
Lorsque Leibniz affirma : « Dieu est absolument bon et absolument juste », on lui demanda : si cela est vrai, pourquoi existe-t-il le malheur et la souffrance dans ce monde ? Leibniz répondit : « Parce que ce monde est le meilleur de tous les mondes possibles. » Si Dieu avait pu créer un monde meilleur et ne l’avait pas fait, Il n’aurait pas agi conformément à la raison ; et il est insensé de concevoir Dieu comme un être qui n’agit pas conformément à la raison. Ce monde est donc le meilleur qu’Il pouvait créer.
Dans son ouvrage Théodicée (du grec theos = Dieu, dike = justice), il suppose que la somme du bien est supérieure à la somme du mal, et que le mal est une nécessité, le sous-produit d’un bien supérieur, par exemple la liberté. Dans un monde où il n’y aurait aucun mal, la liberté ne pourrait pas exister, puisque la notion même de libre arbitre implique la possibilité du péché.
On peut distinguer le mal métaphysique (imperfection), le mal physique (souffrance) et le mal moral (péché). Ainsi, même si le mal physique et le mal moral ne sont pas nécessaires en soi, il suffit qu’ils soient possibles.
Le problème du mal est un problème théologique classique pour toute religion monothéiste qui affirme qu’un Dieu tout-puissant et infiniment bon est le créateur de tout. La difficulté est évidente : comment concilier l’existence d’un tel Dieu avec le fait du mal dans le monde ?
Les religions dualistes ont résolu ce problème en postulant deux principes (le bien et le mal, ou une variante de cette opposition) : le principe du bien étant responsable de ce qui est bon, et le principe du mal de ce qui est mauvais. Les théologiens scolastiques du Moyen Âge, quant à eux, ont nié l’existence d’un tel principe du mal, expliquant le mal comme absence de bien, à l’image de l’obscurité qui n’est que l’absence de lumière.
Le philosophe américain contemporain Alvin Plantinga a démontré que, du fait de la liberté humaine, un Dieu tout-puissant n’a pas pu créer un monde où existerait le bien moral sans possibilité du mal moral. Dieu peut créer des créatures libres, mais Il ne peut pas déterminer qu’elles fassent toujours le bien ; car si cela était, elles ne seraient plus vraiment libres. Pour créer des êtres capables de bien moral, Dieu devait donc créer des êtres capables aussi de mal moral.
Rappelons ici deux distinctions : tout péché est un mal, mais tout mal n’est pas un péché.
Par exemple, si une personne hérite d’une maladie à cause de l’alcoolisme de ses parents, elle porte ce mal et souffre de ce mal, mais elle n’en est pas coupable. Ce n’est pas un péché, mais un mal. Ainsi, tout péché est mal, mais tout mal n’est pas le péché de celui qui le subit.
La Bible décrit le péché de plusieurs façons. Dans l’Ancien Testament, le mot hébreu het ( חֵטְא ) signifie « manquer le but », « échouer ». Pécher, c’est donc manquer le sens de sa vie, échouer comme être humain.
Un autre terme, ʿavon (עָוֹן), signifie « perversion, déformation » : l’homme déforme sa nature et s’écarte de la voie juste.
Un troisième terme, peshaʿ (פֶּשַׁע), signifie « rupture de l’alliance » : être homme, c’est être en alliance avec Dieu, et être Dieu, c’est être en alliance avec l’homme. Rompre cette alliance, c’est s’égarer, se pervertir, échouer complètement, manquer le but de l’existence.
Dans le Nouveau Testament, rédigé en grec, les mots employés sont adikia (ἀδικία, « injustice, agir contre la justice ») et hamartia (ἁμαρτία, « manquer le but, s’égarer »).
Ces expressions montrent la gravité du problème du mal dans « le meilleur des mondes possibles ».
Examinons de plus près le problème du mal dans « le meilleur des mondes possibles », à travers la pensée de l’un des grands philosophes contemporains, Leszek Kołakowski.
Un aperçu des réflexions humaines sur le mal équivaudrait à une récapitulation de l’histoire entière de la théologie, de la philosophie, de la religion et de la littérature – de la Rigveda, en passant par Platon, Dostoïevski, jusqu’à Ionesco. De même, un examen de l’action du mal dans la vie humaine coïnciderait pratiquement avec l’histoire universelle – des tribus paléolithiques jusqu’à notre époque.
Deux grandes approches – chacune possédant de nombreuses variantes – ont été proposées par les philosophes, théologiens, scientifiques et simples mortels, au fil des siècles, pour affronter le fameux « problème du mal »:
- on peut soit tenter de le résoudre,
- ou l’écarter en affirmant qu’il est mal posé, voire inexistant.
Parmi ceux qui ont voulu approfondir la question, on distingue deux options métaphysiques opposées : celle des manichéens et celle des chrétiens. Parmi ceux qui ont choisi de la mettre hors-jeu (pour des raisons diverses), on trouve certains mystiques, quelques panthéistes, tous les marxistes et communistes, la plupart des autres utopistes, les partisans d’une vision naturaliste du monde (comme les disciples de Nietzsche), les nazis ou encore certains darwinistes philosophants.
L’idée du mal comme pure négativité découle directement de la foi en un Créateur unique, infiniment bon. C’est une déduction, et non une donnée de l’expérience. La théodicée chrétienne a fourni un effort immense et héroïque pour répondre à la question du mal telle que la pose le sens commun. Quand saint Augustin affirme que l’existence même du mal doit être bonne, puisque Dieu n’aurait pas permis son apparition autrement, il exprime quelque chose de cohérent dans les catégories chrétiennes : tout est bon, et l’existence elle-même (par elle-même) est un bien. Cette conviction procède de l’idée de Dieu : Dieu aurait pu ne pas permettre le mal, mais, pour des raisons qui Lui sont propres, Il l’a laissé advenir.
Leibniz explicite davantage ces raisons, par voie déductive également. Il démontre la nécessité d’un Dieu infiniment bon, car ce Dieu a créé le monde le plus parfait logiquement concevable – celui dans lequel nous vivons ; tout autre aurait été pire. Les railleries célèbres de Voltaire dans Candide paraissent superficielles face à cette argumentation. Leibniz n’ignorait pas les horreurs de la vie, mais sa conviction en la bonté suprême de la création demeurait ferme, car elle fondait l’idée même de Dieu. Dans sa sagesse infinie, Dieu a résolu une équation d’une complexité sans limite, déterminant quel monde pouvait offrir le maximum de bien.
La tradition chrétienne, à la suite de Platon, a toujours distingué entre le mal moral (malum culpae) et la souffrance. Le mal moral est une conséquence inévitable de la liberté humaine : le Créateur a jugé que le monde habité par des êtres doués de raison et de libre arbitre, donc capables de mal, produirait davantage de bien que celui peuplé d’automates programmés, incapables de mal, mais aussi de véritable bien.
Quant aux souffrances qui ne proviennent pas de l’action humaine (malum poenae, « mal de punition » dans la terminologie chrétienne), deux explications sont proposées. La première y voit l’action des esprits mauvais, que Dieu permet afin de punir, corriger ou avertir. La seconde, dans l’esprit de Leibniz, y reconnaît le résultat des lois de la nature, car Dieu n’est pas « tout-puissant » au sens d’un arbitraire illimité : Il n’a pas créé un monde où les phénomènes seraient incohérents et contradictoires, mais un monde soumis à un ordre rigoureux.
Les penseurs chrétiens qui, à la manière de certains nominalistes ou d’auteurs modernes comme Léon Chestov, ont affirmé que Dieu était absolument tout-puissant (pouvant même changer le passé, décréter de nouvelles lois mathématiques ou morales), se sont exposés à l’accusation traditionnelle d’épicurisme : puisqu’il existe du mal, Dieu est alors soit mauvais, soit impuissant, voire les deux. Mais cette critique ne touche pas la théodicée leibnizienne : pour Leibniz, les règles de la logique et des mathématiques ne limitent pas la toute-puissance divine, car elles s’identifient à Lui. Ainsi, nous n’avons pas à nous plaindre de ne pas vivre dans un monde « paradisiaque » sans souffrance, ni à reprocher à Dieu de ne pas abolir les lois de la nature ou empêcher les guerres, tortures ou Auschwitz. Comme le rappelle saint Augustin : « Les miracles ne se produisent pas contre la nature, mais contre ce que nous croyons savoir d’elle. »
Tout cela est bien connu, et pourtant beaucoup d’esprits ne trouvent pas, dans cette construction théologique, de réponse satisfaisante au mal qu’ils perçoivent et affrontent. Le sens commun peine à admettre que le mal n’est qu’une « non-existence », que le diable, en tant qu’être, est bon, et que les douleurs humaines seraient des éléments d’un système parfait conçu par Dieu. Spontanément, il se range plutôt aux questions de Voltaire après le tremblement de terre de Lisbonne : « Le monde aurait-il été pire sans cette catastrophe ? » De même, pouvons-nous demander : « Le monde aurait-il été pire sans Auschwitz et le Goulag ? Mon doigt aurait-il dû se couper pour avoir épluché une pomme de terre ? »
Regardons d’un peu plus près le problème du mal dans « le meilleur des mondes possibles » à travers la vision de l’un des grands philosophes contemporains, Leszek Kołakowski.
Un aperçu des réflexions humaines sur le mal correspondrait pratiquement à une vue d’ensemble de toute l’histoire de la théologie, de la philosophie, de la religion et de la littérature – depuis le Rig-Veda jusqu’à Platon, Dostoïevski et Ionesco. De même, une revue des effets du mal dans la vie humaine équivaudrait à passer en revue toute l’histoire de l’humanité – depuis les tribus du Paléolithique jusqu’à nos jours.
On connaît deux approches principales – chacune ayant d’innombrables variantes – par lesquelles philosophes, théologiens, savants et même de simples hommes ont tenté, au fil des siècles, de se confronter à ce que l’on appelle le problème du mal. Comme pour toutes les grandes questions humaines, on peut essayer soit de « résoudre » le problème, soit de le dissoudre en affirmant qu’il est mal posé ou qu’il n’existe tout simplement pas. Parmi ceux qui ont cherché à approfondir la question du mal, nous trouvons les partisans de deux options métaphysiques opposées : les manichéens et les chrétiens. Parmi ceux qui ont choisi d’écarter la question (pour des raisons diverses), on compte certains mystiques, certains panthéistes, tous les marxistes et communistes, la plupart des autres utopistes, ainsi que nombre de prédicateurs d’une vision naturaliste du monde – tels que les disciples de Nietzsche, les nazis ou encore certains darwinistes philosophants.
La notion du mal comme pure négativité découle directement de la foi en un seul Créateur qui, étant l’Unique, est aussi infiniment bon. Il s’agit donc d’une déduction et non d’une donnée de l’expérience. La théodicée chrétienne a fourni un effort immense, héroïque, pour répondre à la question très concrète que se posent les hommes au sujet du mal. Quand saint Augustin affirme que la simple existence du mal doit être bonne, puisque autrement Dieu ne l’aurait pas permis, il exprime quelque chose d’évident dans les catégories chrétiennes : tout est bon, c’est-à-dire que l’existence en tant que telle (le fait d’être) est bonne. Cette idée découle directement de la conception de Dieu ; elle suppose que Dieu aurait pu ne pas permettre le mal, mais que, pour des raisons qui Lui sont propres, Il l’a permis. Leibniz précise ces raisons en recourant, lui aussi, à la déduction. Il démontre nécessairement l’existence de Dieu – et plus encore Sa bonté suprême – en affirmant que Dieu a créé le monde le plus parfait possible du point de vue logique, et que ce monde est précisément le nôtre ; tout autre monde eût été pire. Les célèbres moqueries de Voltaire (dans Candide) paraissent alors trop faciles et superficielles. Leibniz était parfaitement conscient de l’horreur de l’existence. Et pourtant, la foi en la suprême bonté de la création demeure inébranlable dans l’affirmation d’un tel Dieu. Dans Sa sagesse infinie, Dieu a résolu une équation d’une complexité sans limite, par laquelle Il a déterminé la forme d’un monde offrant le maximum de bien possible.
La tradition chrétienne, suivant Platon, a toujours insisté sur la différence entre le mal moral et la souffrance. Le mal moral (malum culpae) est la conséquence inévitable de la présence de la liberté humaine, car le Créateur a jugé qu’un monde habité par des êtres raisonnables, dotés de libre arbitre – donc capables aussi bien de mal que de bien – produirait davantage de bien qu’un monde peuplé d’automates programmés qui n’auraient jamais commis de faute. En effet, ces derniers n’auraient pas pu davantage accomplir le bien, puisque nous appelons « bonnes » les actions qui sont choisies librement, et non celles qui sont accomplies par contrainte.
Quant aux souffrances qui ne sont pas directement causées par l’homme (malum poenae – « mal de peine », selon la terminologie chrétienne), deux réponses sont possibles. La première affirme que ces souffrances proviennent des esprits mauvais, que Dieu permet afin de nous punir, nous corriger, nous avertir, etc. La seconde, plus proche de Leibniz, explique que de telles souffrances découlent des lois de la nature elles-mêmes, car Dieu n’est pas tout-puissant dans le sens d’une toute-puissance arbitraire qui pourrait relier et accorder tout avec tout dans un système où les phénomènes ne suivraient pas strictement des règles fixes et où aucun conflit ne serait possible.
Les penseurs chrétiens qui, à la manière des nominalistes tardifs – et parmi les modernes, Lev Chestov –, croyaient que Dieu est absolument tout-puissant, capable par exemple de changer le passé ou d’instaurer par décret de nouvelles lois mathématiques et morales, s’exposaient à une critique traditionnelle : le reproche d’épicurisme (nous avons déjà évoqué Épicure et sa fameuse question). Puisqu’il y a du mal, Dieu est ou bien mauvais, ou bien impuissant, ou bien les deux à la fois. Cette critique, toutefois, ne s’applique pas à la théodicée de Leibniz, qui soutient que Dieu ne peut pas modifier les règles de la logique ou des mathématiques, sans que cela limite pour autant Sa toute-puissance : ces règles sont valides en elles-mêmes, elles ne s’imposent pas à Dieu de l’extérieur, mais s’identifient à Lui-même. Dès lors, il n’y a pas lieu de se plaindre ni de demander pourquoi Dieu n’a pas créé un monde paradisiaque exempt de souffrances. En réalité, Dieu ne nous a jamais promis d’abolir les lois de la nature ni de multiplier les miracles pour notre confort, ni même d’empêcher les hommes de se nuire les uns aux autres, que ce soit par des guerres, des tortures ou des Auschwitz. Et saint Augustin de rappeler : « Les miracles ne se produisent pas en contradiction avec la nature, mais seulement en contradiction avec ce que nous croyons être la nature. »
Tout cela est bien connu. Pourtant – étrange ou non –, beaucoup d’hommes n’ont pas trouvé, dans ce schéma théologique, de réponse satisfaisante à l’expérience du mal qu’ils constatent et contre lequel ils doivent lutter. Pour le bon sens ordinaire, il n’est guère convaincant d’entendre que le mal n’est qu’un pur non-être, une simple négativité ; que le démon, en tant qu’être existant, est bon ; et que les souffrances et les douleurs humaines font partie intégrante du système le plus parfait que Dieu ait pu concevoir pour le monde. L’esprit commun est plutôt enclin à répéter la célèbre question que Voltaire posait après le tremblement de terre de Lisbonne : le monde aurait-il vraiment été pire sans cette catastrophe ? Et nous aussi, semble-t-il, pouvons poser la question : le monde aurait-il été pire sans Auschwitz et sans le Goulag ? Et moi, me serais-je nécessairement coupé le doigt si je n’avais pas épluché de pommes de terre ?
Arrêtons un instant Kołakowski pour ajouter une remarque personnelle : il utilise ici deux faits qui paraissent reliés non seulement dans le temps et dans l’espace, mais encore par un lien direct de cause à effet. Cela ressemble à une citation sortie de son contexte, car ce raisonnement néglige la multitude de pommes de terre qui furent épluchées sans qu’aucun doigt ne soit coupé. Un tel exemple ne saurait illustrer l’existence d’un bien caché – ou plutôt d’un ensemble de biens cachés – qui, dans la suite du temps, seraient liés à une catastrophe naturelle comme un tremblement de terre. Mais revenons à Kołakowski.
La question de savoir si le monde aurait été pire sans le tremblement de terre de Lisbonne est, à la lumière de la sagesse de Leibniz et de tout théologien chrétien, une fausse question. Car aucun théologien ne peut prétendre disposer de l’algorithme divin qui permettrait de montrer que tel ou tel fait particulier de mal ou de souffrance, examiné en profondeur, serait en réalité un bien dans le bilan global infini, en ce sens que chaque mal empêcherait un plus grand mal ou rendrait possible un plus grand bien. Ce bilan n’est connu que de Dieu, et il est vain – sans espoir – pour nous de chercher à le reconstituer. Nous n’avons d’ailleurs aucun moyen de mesurer ni de comparer quantitativement des formes de mal et de bien dans leur diversité infinie.
En vérité, notre position consiste à faire confiance d’avance aux desseins divins, sans calculs ni récriminations ; à les accueillir en sachant qu’ils incluent à la fois les malheurs humains et l’indifférence destructrice de la nature. Quant à l’idée, issue à la fois de saint Augustin et de Hegel, selon laquelle le mal serait nécessaire pour des raisons esthétiques – parce qu’il enrichirait le monde de contrastes et de différences –, elle a beau être surprenante et provocatrice, elle demeure profondément choquante.
Nous pouvons ainsi comprendre le besoin de l’esprit humain de chercher une autre solution, que l’on appelle – à tort ou à raison – manichéenne. Cette solution nous ramène à l’ancienne mythologie iranienne : elle est persuasive et paraît en accord avec l’expérience quotidienne. Elle affirme qu’il existe deux forces, ou deux dieux jumeaux, qui s’affrontent, et que le mal dont nous faisons l’expérience – la souffrance – est l’œuvre du mauvais souverain.
La théologie manichéenne, à la différence de ses sources zoroastriennes mais en accord avec certains courants gnostiques (et en désaccord avec la doctrine chrétienne), voyait dans la matière elle-même une œuvre des puissances mauvaises. L’image manichéenne du monde a constamment tenté l’esprit chrétien et, plus largement, l’esprit européen. Les forces sataniques, d’où qu’elles viennent, s’efforcent sans relâche, et souvent avec succès, de ruiner les bons desseins de Dieu. C’est une pensée qui semble correspondre au bon sens. Voilà pourquoi notre esprit peut accueillir sans grande peine le manichéisme, ce qui explique sa diffusion historique et, en conséquence, les luttes acharnées que l’Église ancienne mena contre ses différentes formes.
Certains platoniciens de l’Antiquité – par exemple Plutarque de Chéronée ou Numénius d’Apamée – croyaient eux aussi en deux puissances indépendantes, le bien et le mal. Pour Plotin, en revanche, le mal n’était rien d’autre que l’échelon le plus bas, inévitable, de l’échelle de l’Être.
Il est évident pour chacun que les souffrances et les catastrophes, selon les critères ordinaires, frappent au hasard, et qu’il est impossible de les interpréter en termes de mérite, de faute, de récompense ou de châtiment. Job le savait bien, et c’est pourquoi il ne chercha pas à bâtir une théodicée. Sa vie entière avait été celle d’un homme intègre, et Dieu le savait. Ses malheurs ne sont pas la dette payée pour des crimes secrets. Job souffre atrocement sans raison, mais il déclare : « Voici, qu’Il me tue, je continuerai à espérer en Lui… » (Livre de Job 13,15). Il s’incline devant l’idée que Dieu est la source de toute sagesse et que Ses voies sont insondables. Dieu Lui-même se fâche contre les conseillers de Job, ces théologiens, sans doute parce qu’à leurs yeux ses souffrances constituaient un châtiment mérité pour ses péchés. Le Livre de Job, dans son ensemble, semble ruiner la théorie de la souffrance comme juste punition.
Dans différentes mythologies, le mal peut recevoir une explication. Pour les sages bouddhistes, et probablement pour Gautama lui-même, le monde tel que nous le connaissons à travers l’expérience n’est qu’infortune et souffrance ; la délivrance et le salut reposent uniquement sur l’abandon d’un tel monde. Cette pensée n’est pas étrangère à divers penseurs européens. Nous nous souvenons tous des paroles immortelles du mourant Socrate : « Criton, nous devons un coq à Esculape. Payez cette dette, ne soyez pas négligents » Cela signifie, peu ou prou : ici s’achève la maladie qu’on appelle la vie.
Pourtant, ce n’est pas une conviction universelle. Certains panthéistes et mystiques ont été si profondément immergés dans l’espace divin qu’ils ont cessé de percevoir le mal. La lumière divine pénètre tout, il n’y a aucune raison de se lamenter : le monde est rempli de joie. Comme le dit Maître Eckhart : « Ce qui vient de Dieu est Dieu. » La seule chose en ce monde qui s’oppose à Dieu, affirme Ralph Cudworth, platonicien de Cambridge, c’est le péché, car le péché est un non-être, un néant. Dieu Lui-même déclara à Catherine de Sienne qu’aucune souffrance ne peut racheter notre péché, mais que seul le repentir le peut ; et Il ajouta que le pire péché est le refus ou le manque de confiance en la miséricorde divine. Cela signifie que le désespoir de Judas constitua un plus grand péché, une offense plus grave envers Dieu que la trahison du Christ.
De telles explications suggèrent que notre volonté, nos intentions, nos actions peuvent être considérées d’un point de vue moral : faire souffrir les autres par malveillance constitue un mal, tandis que supporter la douleur n’en est pas un. Cela peut s’accorder avec la doctrine morale des stoïciens, mais non avec le bon sens, qui nous enseigne le devoir de condamner non seulement notre propre mal, mais encore le mal tout entier présent dans le monde des hommes.
Ici surgit une autre restriction. Si nous réduisons le mot « mal » à ce qui relève de la volonté humaine, alors nous ne pouvons pas étendre son sens jusqu’à inclure les souffrances provoquées par les forces de la nature, ou par l’action humaine, mais dont les conséquences douloureuses et nuisibles n’avaient pas été intentionnellement planifiées, n’étant survenues que par hasard. Étant donné que la première association du mot « mal » est morale, son application, par exemple, à un tremblement de terre, une épidémie ou une mort frappée par la foudre, suggère que rien ne survient comme conséquence des opérations aveugles des lois de la nature, mais que tout se produit en vertu d’une intention déterminée. C’est, bien sûr, une manière religieuse de déchiffrer le monde, et elle peut s’accorder avec le refus d’admettre l’autonomie des lois naturelles. Selon de nombreux théologiens, Dieu, par sa prescience, a intégré les événements naturels dans l’ordre moral du cosmos : ils se déroulent grâce aux forces irréfutables de la nature et, en même temps, possèdent un objectif moral. Nous ne les comprenons donc pas comme des miracles interrompant le système des causes et des effets. Une telle lecture est plus proche de la conception leibnizienne du monde.
Ceux qui, pour des raisons religieuses, annulent – directement ou indirectement – la « question du mal » croient, bien entendu, au bien, puisque le bien imprègne l’univers tout entier, matériel et spirituel. À l’extrême opposé du spectre théologique ou antithéologique se trouvent ceux qui soutiennent que le bien et le mal ne sont que des fragments mythologiques. Il existe, bien sûr, le plaisir et la douleur, mais ils peuvent être expliqués dans les limites de l’ordre naturel des choses. Ces expériences, en elles-mêmes, ne possèdent aucune valeur morale intrinsèque. Rien n’est mal ou bien en soi : une chose peut être agréable ou désagréable, utile ou nuisible – avec la précision « pour moi, pour toi, pour lui ». Les mots « agréable » et « désagréable », en revanche, vont sans cet ajout, et il en va de même pour « bien » et « mal » lorsqu’ils sont dépourvus de contenu. C’est à peu près ce que pensaient Hobbes, Hume, et même Spinoza (bien que son cas soit plus complexe). Nietzsche, lui, considérait que nous n’avions pas besoin du mot « mal » et qu’il suffisait de parler de « non-bien ». Mais qu’est-ce que le non-bien ? Probablement ce qui entraîne des conséquences non désirées ou ce qui échoue à atteindre le but que nous poursuivons. Une doctrine semblable nous est suggérée par le titre de l’ouvrage célèbre de Konrad Lorenz sur l’agression, qui porte le titre : Le soi-disant mal.
Job et la littérature
Et comment l’artiste le voit-il ? Prenons un court exemple. Alexandre Soljenitsyne, dans son roman L’Archipel du Goulag, écrit :
« Peu à peu, il m’est apparu que la ligne qui sépare le bien et le mal ne passe pas entre les États, ni entre les classes, ni entre les partis – elle traverse chaque cœur humain – et tous les cœurs humains… même dans le cœur envahi par le mal, elle conserve un petit recoin de bien. Et même dans le meilleur des cœurs demeure un minuscule recoin de mal, impossible à déraciner… »
Dans la littérature moderne, nous retrouvons Job chez Dostoïevski, Sima Matavulj, Goethe… Lord Byron, après avoir lu ce livre, affirme que l’histoire du genre humain est une « diavodicée » (un chemin diabolique).
Comment cela apparaît-il chez Dostoïevski ? Certains estiment que ce qu’on appelle « l’athéisme révolté » est une réaction à la théodicée qui interprète la souffrance et le mal dans le monde comme conséquence du libre arbitre. La question théodicéenne, au sens strict – à savoir la question de Dieu et de la souffrance – est née du croisement entre la conception philosophique grecque d’un monde régi par des principes rationnels et le discours biblique et chrétien sur un Dieu tout-puissant qui ne veut pas la souffrance, mais la permet à cause d’un plus grand bien qu’implique l’existence du libre arbitre, bien que cela suppose aussi son abus.
En considérant ainsi théologiquement la notion de théodicée, on peut clairement relier le Livre de Job au roman Les Frères Karamazov. Ce lien apparaît dans le chapitre « Révolte », dans le dialogue entre Ivan Karamazov et son jeune frère Aliocha. Rejetant l’opinion traditionnelle selon laquelle le problème de la théodicée se résout par une harmonie finale, Ivan anticipe la nécessité d’une autre solution, que l’on trouve dans la réponse du jeune Aliocha :
« Mais cet Être existe, et Il peut tout pardonner, tout et à tous, et pour tout, parce qu’Il a Lui-même donné son sang innocent pour tous et pour chacun. C’est Lui que tu as oublié, et c’est sur Lui que l’édifice est bâti ; c’est à Lui que l’on criera : Tu avais raison, Seigneur, car Tes voies se sont ouvertes. »
Le lien est particulièrement visible dans les paroles du starets Zosime, qui, avant sa mort, évoque le Livre de Job :
« … Je ne puis lire sans larmes ce récit sacré. Et combien de grandeur, de mystère et d’inconcevable y a-t-il là ! J’ai entendu les paroles de railleurs et de blasphémateurs, ces paroles orgueilleuses : comment le Seigneur a-t-il pu livrer Son saint bien-aimé au démon pour s’amuser, lui ôter ses enfants, le frapper de maladies et de plaies au point qu’il grattait son pus avec un tesson, et pour quoi ? Juste pour pouvoir se glorifier devant Satan : Voilà, dit-Il, ce que peut supporter Mon saint pour Moi ! Mais la grandeur réside justement dans ce mystère – dans ce contact entre l’image passagère terrestre et la vérité éternelle. Devant la vérité terrestre s’accomplissait l’acte de la vérité éternelle. Là, le Créateur, comme aux premiers jours de la création, achevait chaque jour par une louange : Tout ce que j’ai fait est bon – Il regardait Job et se glorifiait à nouveau de Sa créature. Et Job, en louant le Seigneur, servait non seulement Dieu, mais aussi toute Sa création, de génération en génération et à jamais, car telle était sa destinée. Seigneur, quel livre et quelles leçons ! »
Ainsi, Dostoïevski voit Job avec des yeux néotestamentaires : pour lui, Job est le sommet de la dignité humaine. Il insiste sur Job parce qu’il considère que l’homme ne peut s’améliorer par des choses matérielles, mais seulement par l’alliance avec le Christ et avec Dieu.
La conclusion de Job dans son discours final est le sommet de l’épopée : nulle part dans la littérature la quintessence de la dignité humaine dans un monde aliéné n’a été exprimée plus fortement que par cette créature misérable qui gratte ses ulcères avec un tesson. Ici surgit pour le lecteur une question capitale : quelle perte l’homme doit-il subir pour commencer à se transformer ? Job a réussi à vaincre les tentations dans lesquelles il s’est trouvé par la patience, la souffrance et le renoncement.
Le chemin de Job est le chemin de l’ascèse – l’ascèse du témoignage de la foi !
Le mérite et la théologie rétributive
Saint Job le Juste
Une attention particulière mérite d’être portée aux amis de Job, qui, ayant appris son malheur, viennent lui rendre visite : ce sont peut-être des « consolateurs importuns », mais ils ne sont ni stupides ni malveillants. Ils ne gagnent rien à venir le voir, et leurs motivations sont tout à fait honorables. Les amis de Job défendent l’enseignement traditionnel : ils cherchent à découvrir ce qui a causé les malheurs de Job. Ils pensent que Job a, d’une certaine manière, perturbé l’équilibre de la justice divine, et que cet équilibre doit être rétabli. Tous ces interlocuteurs sont des hommes très pieux, et la seule explication qui ne leur vient pas à l’esprit est celle déjà donnée au lecteur : que Dieu, devant Satan, s’est glorifié de la fidélité de Job. Une telle idée leur paraît insensée et blasphématoire.
Les amis de Job, tous des hommes âgés, ont dit ce qu’ils avaient à dire. Élihu, qui est jeune, doit encore prononcer son discours : ils symbolisent ensemble le cycle ininterrompu de la voix de la loi et de la sagesse. Le jeune maître de sagesse expose, sous forme de monologue apodictique, sa propre explication, qui s’oppose en partie aux amis de Job, mais encore davantage à Job lui-même. Il intervient d’un ton brusque, sûr de lui, inattaquable. Pourtant, lui non plus ne parvient pas à résoudre le problème posé. Son argumentation, ses discours, ne font qu’accentuer les positions, et manifestent plus clairement encore qu’il est impossible aux hommes de résoudre le problème de la grande épreuve de Job, de sortir l’homme de l’abîme de la souffrance.
Job laisse Élihu parler et ne l’interrompt pas de commentaires. Tout cela, il l’a déjà entendu. Il attend une voix tout autre.
Il attend d’entendre ce que signifie « mériter » quelque chose.
Le mérite comporte généralement trois éléments fondamentaux :
• le sujet méritant (la personne ou les personnes),
• l’objet mérité (louange, blâme, récompense),
• et le fondement du mérite (effort, progrès, contribution).
Les hommes se comportent souvent entre eux selon la logique du mérite. La société affirme que les hommes sont capables de mériter, entre autres, une punition, une récompense, une louange, un blâme, un salaire, des notes, une propriété.
L’idée de mérite constitue l’un des fondements moraux qui encadrent le contexte de la philosophie religieuse de la théologie rétributive, c’est-à-dire de la théologie de la rétribution. Elle occupe donc une place particulièrement importante dans le Livre de Job, qui examine les questions centrales relatives à la justice divine – notamment : le destin de l’individu a-t-il un rapport quelconque avec la manière dont cet individu vit?
Job se concentre sur la souffrance présente dans cette vie, évitant toute réponse eschatologique à la question de la souffrance du juste.
Arrêtons-nous brièvement sur le concept d’eschatologie, important pour notre sujet. L’eschatologie est la conception de la nature essentielle du but ou de la fin ultime de l’existence. L’eschatologie chrétienne (du grec τὸ ἔσχατον – ce qui est dernier, ultime) est l’enseignement chrétien sur les événements à venir (le salut et l’établissement du Royaume de Dieu ou de la vie éternelle) qui se produiront à la fin de l’histoire, lorsque le Christ viendra juger les vivants et les morts (Éph 1,20-23 ; 1 Th 5,1-11).
Il ne faut pas confondre l’eschatologie avec « la fin du monde », ni la limiter à la description des événements accompagnant la seconde venue du Christ : résurrection des morts, jugement dernier, paradis et enfer. Le terme « eschatologie » englobe le nouvel ordre de l’existence, l’état de transformation ultime, objet de la prière et de l’espérance chrétienne : « Que ton Règne vienne. »
Donc, une fois encore : Job se concentre sur la souffrance présente dans cette vie, évitant toute réponse eschatologique à la question de la souffrance du juste.
Bien qu’il semble que Job et ses amis agissent dans le même cadre théologique, les prétendus consolateurs soutiennent une position traditionnelle que Job rejette, car elle implique des concepts qu’il cherche à élargir afin d’en dévoiler la nature apparemment illogique. Sophar expose de manière concise le cadre de la théologie de la rétribution :
« Ne sais-tu pas que c’est ainsi de tout temps, depuis que l’homme a été placé sur la terre,
que le triomphe des méchants est bref, et la joie de l’impie momentanée ? » (Job 20, 4-5)
« Les cieux révéleront son iniquité, et la terre s’élèvera contre lui. » (Job 20, 27)
Job se révolte contre cette conception traditionnelle de la justice cosmique. Il montre une réalité où les méchants prospèrent :
« Pourquoi les méchants vivent-ils, vieillissent-ils, et deviennent-ils puissants ? »
« Leurs maisons sont en paix, sans crainte, et le bâton de Dieu ne pèse pas sur eux. » (Job 21, 7, 9)
Si le péché entraîne la ruine, pourquoi Job souffre-t-il sans l’avoir mérité ? Comment cela peut-il être juste ?
En affrontant cette question, Job dévoile une philosophie complexe du mérite, comportant plusieurs éléments essentiels. Job est juste. Il est innocent, pur, intègre, craint Dieu et s’éloigne du mal. À l’opposé, les méchants sont décrits aux chapitres 21 et 24. Il est clair que le concept de justice ne peut exister sans mérites acquis. Comment imaginer un homme vraiment juste qui n’aurait pas mérité sa justice par ses actes ? La présentation de l’absolue justice de Job est irréfutable : « Il n’y a personne comme lui sur la terre » (Job 1,8 ; 2,3). Il est donc sous-entendu qu’il existe un mérite. Job le confirme en maintenant son innocence et en défendant sa droiture tout au long du livre. En conclusion, Dieu confirme à nouveau la justice de Job en 42,7-9.
Il est compréhensible que le fondement du mérite doive être lié en fait au sujet méritant. De même, le sujet méritant doit être responsable de ce fondement. Ainsi, A mérite x en raison de y, seulement si A est responsable de y.
Cependant, Satan conteste la capacité de Job au mérite : à la fois son mérite pour sa propre justice, et son mérite pour les biens dont Dieu l’a béni :
« Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l’as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l’œuvre de ses mains, et son troupeau s’accroît dans le pays… » (Job 1,9-10)
L’épreuve proposée devait donc déterminer si Job était responsable de sa justice. Dieu affirme que Job est juste, mais Satan conteste l’idée même que l’homme puisse l’être.
Les amis de Job, eux aussi, rejettent la notion de mérite. Éliphaz de Théman dit :
« L’homme serait-il plus juste que Dieu ? L’homme serait-il plus pur que son Créateur ? S’il n’a pas confiance en ses serviteurs, s’il trouve des défauts à ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d’argile, qui ont pour fondement la poussière, et que l’on écrase plus vite qu’un ver ! » (Job 4,17-19)
La réponse d’Éliphaz est que Dieu est indubitablement juste, et que toute relation avec Lui requiert des hommes qu’ils reconnaissent leur véritable place dans la hiérarchie de la création. Il ne leur revient pas de discuter avec Dieu du mérite moral, même face à des preuves apparemment irréfutables contre la justice divine. Les expériences individuelles ne peuvent renverser la justice divine, car l’homme n’a pas les capacités nécessaires pour revendiquer un mérite devant Dieu.
Ces arguments d’Éliphaz représentent une manière d’éviter le problème du mérite. Il affirme que les hommes ne méritent en réalité rien, car ils ne sont responsables d’aucune des contingences de leur existence. Ainsi, tout fondement possible du mérite repose sur ce dont les hommes ne sont pas responsables. Comme les êtres humains ne peuvent rien mériter, le témoignage de Job sur sa punition imméritée n’est manifestement pas valide.
Bien que le Livre de Job propose de nombreuses théories séduisantes permettant de rejeter l’idée de mérite, le débat en réalité réfute ce genre de subterfuge philosophique : Dieu confirme véritablement la justice de Job en confirmant son mérite. Job demeure ferme dans sa justice même après que Dieu a permis à Satan de lui enlever tout ce que l’Adversaire avait désigné comme fondement de sa droiture. Cela prouve le mérite de Job, et il ne peut être ignoré que sa justice est constamment confirmée tout au long du livre. Ainsi est totalement rejeté l’argument selon lequel l’homme serait incapable d’atteindre un quelconque niveau de justice.
En même temps, Job présuppose ce que les théodicées modernes cherchent à démontrer : la justice de Dieu.
Par conséquent, le Livre se présente plus précisément comme une tentative de corriger et de redresser la théologie erronée de la rétribution, laquelle faisait partie intégrante de la culture juive au moment de sa rédaction.
À cette époque, les maîtres de sagesse enseignaient que l’application de la raison humaine pouvait apporter succès et bonheur. En observant la loi divine, les hommes pouvaient influencer favorablement le cours de leur vie. Négliger les commandements de Dieu entraînait souffrance et malheur. La sagesse permettait d’accéder à la connaissance et au bonheur, et une observance juste de la loi procurait un mérite favorable.
Mais le contrat social, c’est-à-dire l’accord autour de cette sagesse, offre-t-il réellement aux hommes la capacité d’atteindre un mérite véritable ? Les fondements du mérite proviennent-ils directement de l’institution – en l’occurrence du consensus social largement accepté ?
Si tel est le cas, alors le fondement du mérite est déterminé par les règles ou par les objectifs des institutions sociales. Telle est l’une des positions défendues par les contemporains de Job et ses collègues, qui s’efforcent de le ramener sur le droit chemin, c’est-à-dire dans le système social de la théologie rétributive, la théologie de la rétribution. Éliphaz affirme que l’expérience de Job doit être harmonisée avec la sagesse admise par consensus. Il invite Job à « ajuster son expérience personnelle à la vérité reconnue et approuvée par l’opinion majoritaire ».
L’opinion générale de la société dans laquelle vit Job soutient cette position raisonnable, en suggérant un lien causal entre une bonne destinée et la droiture. La souffrance est un fardeau commun à toute l’humanité et un poids solitaire pour chaque individu. Si quelqu’un souffre maintenant, c’est pour un bien plus grand ; la balance s’équilibrera à la fin.
D’un point de vue eschatologique, cette affirmation semble forte ; mais Job proteste contre cette vision. Job n’est pas satisfait d’une justification post mortem. Au contraire, il impose la question de son problème ici et maintenant. Ainsi, le Livre de Job sert à montrer que toute souffrance n’est pas punitive, corrective ou rédemptrice. Certaines souffrances sont absurdes.
Job lui-même souligne l’absurdité de l’épreuve actuelle, qui se manifeste dans le fait que son mérite de bénédiction est éprouvé par des tourments qu’il ne mérite pas.
L’absurdité du mérite se reflète encore dans la question suivante : si Satan a raison et que Job ne peut pas mériter sa justice, peut-on alors dire que les méchants méritent leur punition ?
Il semble que Job [A] mérite une punition [x] en raison de sa justice [y].
Cette situation paraît totalement contraire à toute loi et justice morale raisonnables, et pourtant le lecteur est contraint d’accepter cette réalité par le récit, et de décider si la formule sociale de la justice rétributive est réellement valable.
En fait, le livre exige du lecteur qu’il saisisse la profondeur du problème (les justes souffrent), en ébranlant la sagesse conventionnelle. Ainsi Job conteste la théologie de l’universalité de la justice rétributive. Il ne prétend pas mériter richesse et prospérité à cause de sa justice. Il affirme plutôt qu’il ne mérite pas la souffrance.
Puisque la conséquence immédiate du péché est la séparation d’avec Dieu et le retour au chaos qui cause la souffrance, les amis de Job voient la situation désespérée de leur compagnon de la manière suivante :
Job [A] mérite une punition [x] à cause de son péché [y].
Bien que la raison enseigne que cette équation semble logique, le Livre de Job a confirmé une autre formule – Job [A] mérite une punition [x] à cause de sa justice [y]. La souffrance de Job est en réalité le fruit de sa droiture.
La mesure de l’innocence de Job est soulignée par la condamnation divine de ses prétendus défenseurs :
« …Le Seigneur dit à Éliphaz de Théman : Ma colère s’est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n’avez pas parlé de moi correctement, comme l’a fait mon serviteur Job… » (Job 42,7)
Dieu ne les condamne pas pour leurs tentatives erronées d’expliquer la souffrance de Job comme une punition pour ses fautes, mais parce qu’ils L’ont calomnié et ont déformé Son dessein.
Le rejet par Job de la validité de la justice rétributive – selon laquelle le péché est toujours puni par la souffrance – et son affirmation qu’il n’a commis aucune offense contre Dieu, représentent en miniature ce qui est vrai et correct.
Pourtant, Dieu ne rejette pas totalement les discours des amis de Job. Il condamne seulement leurs accusations injustes contre Job.
Ce fait soulève une autre question : quels aspects des positions des trois amis au sujet du mérite, de la causalité et de la théologie pourraient être valides ? En effet, toutes leurs hypothèses pourraient refléter une part de la justice divine.
Inversement, les discours de Job sont aussi confirmés comme valables. Bien que le discours de Yahvé rejette la tentative de Job d’appeler Dieu à rendre des comptes, Dieu ne réfute pas pour autant les arguments de Job.
Ainsi, il semble que l’auteur propose plusieurs positions contradictoires.
Les deux jugements de Dieu ne permettent pas une conclusion claire et nette du poème. Bien que le Livre confirme l’idée de mérite, il ne prétend pas que ce soit une base valable pour contester la justice divine.
Le Livre de Job n’apporte pas de réponse définitive au problème de la théodicée ; il met plutôt au centre la nature complexe de l’expérience humaine et son influence sur la condition de l’humanité – qu’il s’agisse de souffrance ou de bénédiction.
Il avance divers arguments expliquant la souffrance, mais ne construit pas une théodicée cohérente ni une théorie du mérite. Il examine de nombreuses explications possibles et semble mettre en garde contre les philosophies trop simples et commodes.
En réalité, l’auteur attire volontairement le lecteur à explorer de multiples voies de compréhension de la souffrance imméritée de Job.
Dieu devient amour
Job est peut-être le premier homme qui ait consciemment voulu connaître et comprendre Dieu. Il veut non seulement croire en Lui, mais aussi saisir Ses voies et Ses intentions. Mais il semble que tout homme, de Job jusqu’à aujourd’hui, qui a voulu connaître Dieu, ait dû aussi découvrir l’enfer en lui-même.
Peu importe que le motif de l’entrée de Job en enfer ait été provoqué de l’extérieur, car pour lui aussi, cet enfer extérieur s’est rapidement transformé en enfer intérieur. L’enfer se manifeste toujours à celui qui a ouvert les yeux sur sa propre divinité. Les prophètes, les mystiques et les génies, en tous temps et dans toutes les cultures, en apportent une preuve incontestable.
C’est là aussi l’essence de l’enseignement de la psychologie complexe de Carl Gustav Jung : nul n’est en mesure de connaître la totalité de sa personnalité s’il n’a pas connu également son envers (selon les mots de Jung – son ombre). De même que l’homme a une main droite et une main gauche, ainsi en est-il de Dieu. Clément de Rome enseigne en effet que Dieu gouverne le monde d’une main gauche et d’une main droite. Car, comment autrement comprendre le rôle de Satan ? Dans les Lamentations de Jérémie (3,38), il est écrit :
« N’est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent le mal et le bien ?»
Carl Gustav Jung affirme dans son ouvrage très important Réponse à Job que l’échec de Satan à tenter Job a transformé Yahvé lui-même. La force morale supérieure de Job fut pour Yahvé le signe décisif qu’Il devait devenir homme et accomplir ce qu’Il n’avait pas encore réalisé. Qu’est-ce qu’Il n’avait pas encore accompli dans Sa relation avec l’homme? C’est l’amour !
Le peuple juif, comme d’ailleurs tous les peuples avant lui, ne connaissait qu’un Dieu sévère, implacable, au mieux juste. Mais c’était toujours un Dieu sans Éros. Job recherche quelqu’un au-dessus d’un tel Yahvé, non seulement juste et sage, mais aussi quelqu’un qui aimerait l’homme – le juste et le pécheur de la même manière, et même davantage le pécheur.
« Je sais que mon Rédempteur est vivant », s’écrie Job. Il pressent prophétiquement que viendra quelqu’un qui vaincra la mort, qui se tiendra même au-dessus de sa poussière, quelqu’un qui pardonnera et rachètera le pécheur. Ce quelqu’un accomplira la réconciliation définitive entre Dieu et l’homme, établira un pont permanent et indestructible entre le ciel et la terre.
Un tel exploit ne peut être accompli que par Yahvé Lui-même, qui, devenu homme, traverse aussi l’enfer de la souffrance et de la douleur. La réponse aux souffrances innocentes de Job fut donnée par Dieu lui-même à travers le Christ, au moment où, étant devenu pleinement homme, Il s’écria sur la croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Job a ainsi obtenu pour lui-même et pour tous les hommes que nous n’ayons plus à entretenir en nous une foi aveugle en un Dieu sévère et dur, ce patriarche cruel de plus en plus difficile à comprendre. La nouvelle foi de Job est devenue humanisée ; c’est désormais une foi de compassion et d’amour.
Résurrection du Christ
En guise de conclusion
Mikhaïl Naumovitch Epstein, théoricien littéraire américain et penseur critique d’origine russe, affirme qu’il existe une logique interne dans la structure de l’Ancien Testament, et que ce n’est donc pas un hasard si le Livre de Job précède immédiatement le Cantique des cantiques. Voici pourquoi.
À la question de savoir ce qu’est le bien et le mal, pourquoi le juste souffre tandis que l’injuste ne souffre pas, Dieu (dans le Livre de Job) ne mentionne ni le bien ni le mal, mais parle de la création grandiose offerte à l’homme, de la vie dans le cosmos magnifique : de la mer, de la neige, des animaux, etc. Le problème est ainsi déplacé sur le terrain de l’esthétique, c’est-à-dire du sensible. La réponse à la question du péché et de l’ordre moral injuste dans le monde consiste dans l’exaltation de la beauté de tout ce qui est créé.
Epstein remarque que le récit de la première Genèse sur la création d’un monde merveilleux, suivi de la chute de ce même monde par le péché originel, est présenté dans le Livre de Job de manière inversée. Le Livre de Job est en réalité le reflet en miroir du récit de la première Genèse. Le sens de la réponse de Dieu à Job est qu’il faut revenir de l’arbre de la connaissance du bien et du mal à l’arbre de vie. Car la chute icarienne s’est produite par un mouvement allant de l’arbre de vie vers l’arbre de la connaissance du bien et du mal, et le retour à Dieu n’est possible que par le chemin inverse – en revenant à l’arbre de vie.
La réponse de Dieu à Job nous ramène donc au commencement de l’histoire de la création du monde, à la première Genèse. De la même manière, dans le Cantique des cantiques, nous rencontrons le récit de la vie dans le jardin d’Éden décrit dans la deuxième Genèse. C’est précisément pour cette raison, observe finement Epstein, que le Livre de Job précède le Cantique des cantiques. Ce passage du cosmos (première Genèse) à l’Éden (deuxième Genèse), des forces cosmiques possibles mais inaccessibles au jardin d’Éden, représente aussi le passage du Livre de Job au Cantique des cantiques.
Dans le premier livre, le monde est sublime et inaccessible, et Dieu infiniment éloigné de l’homme, tandis que dans le second, l’homme apparaît dans un jardin préparé pour lui, afin qu’il s’y réjouisse éternellement et en jouisse sans condition.
L’essence du Livre de Job est contenue dans les questions. Sans questions, l’homme ressemble aux amis de Job, ces « créatures corrompues », existences insensées. Le moment où l’homme s’interroge est « l’heure de la naissance de la Lumière », car chaque question est une confirmation de l’être pensant de l’homme, qui l’élève au-delà de ses propres limites. En témoignent justement les paroles de l’archimandrite Justin Popovitch dans son ouvrage Sur l’esprit du temps :
« Il n’est aucune créature devant laquelle l’homme ne se soit incliné sous forme de question.
Il n’est aucune question qui n’ait attiré l’homme dans son infinité.
Car toute question conduit l’homme au-delà des frontières de l’humain, le rend transhumain, transsubjectif, le relie à la nature de l’objet étudié et l’immerge dans l’infini.
Après chaque question surgit une autre question ; et jamais de fin aux questions, jamais de terme aux réponses.
Si ce n’est par autre chose, du moins par ses questions, par ses problèmes, l’homme est infini.
Mais ce sens qui interroge, cet esprit qui interroge, ne sont-ils pas eux-mêmes infinis, puisqu’ils peuvent engendrer une infinité de questions ? »
Rares cependant sont les individus qui posent des questions. Job, il y a plusieurs millénaires, posa une question dont nous cherchons encore la réponse aujourd’hui. Les questions sont nombreuses, mais rares sont ceux qui interrogent. Une humanité largement frustrée, habituée à la forme de l’ordre, attend encore de trouver la force de poser, à l’instar de Job, une question.
Auteur : Dragi Mrđenović
Bibliographie (traduction des titres en serbe) :
• Vladeta Jerotić : Entre l’autorité et la liberté
• Vladimir Petrović : Les souffrances de Job, pour quoi ? (« Le Livre de Job » – possibilités de lecture)
• Sonja Todorović : Job – l’homme qui pose des questions
• Carl Gustav Jung : Réponse à Job
• Leszek Kołakowski : Job ou l’antinomie de la vertu
• Ilija Kapicić : Essai sur la souffrance de l’homme
• Zachary Alexander : Le banquet du mérite : Réflexion sur les principes fondamentaux du mérite dans Job
• Vanja Glumac : Le Livre de Job comme paradigme de la vie humaine
• Goran Tadić : La souffrance dans la littérature extra-biblique et la révélation vétérotestamentaire
• Nikola Jelačić : Le développement de l’idée du mal dans les écrits judéo-chrétiens – du ha-satan au Diable néotestamentaire
• Blagoje Pantelić : Une interprétation ontologique du Cantique des cantiques (L’« édenisme » de Mikhaïl Epstein)
• Eliyahu Yardeni & Yirmiyahu Roe : Le concept de Satan dans le Tanakh : personne, fonction ou autre chose
A découvrir aussi
- Peut-on jouer aux jeux d’argent ?
- La paroisse : une communauté liturgique vivante
- Le Grand Carême orthodoxe et le calendrier du Jeûne 2025